< Retour rubrique Les Deux dernières Guerres mondiales
< Retour à la page-écran d'accueil du STALAG XI A
Né le 22 mai 1919 à Monceau-les-Mines (71), la famille est originaire de la
ville d’Angres (Pas-de-Calais) dans le bassin minier de Lens-Liévin.
Angres se
trouvant sur la ligne de front, sa
famille avait été évacuée en 1915 dans le bassin minier de la Loire où il est
né.
Au moment de sa naissance, Angres, détruite en totalité, n’était toujours
pas en état d’accueillir ses anciens habitants...
Décédé à Dieppe (76) le 1er août 2015.
Yannick CHAUMETTE a été averti tardivement du décès de M. Arthur LOUART
et j'ai mis du temps à mettre en ligne l'émouvant hommage qu'il lui a consacré.
Je m'associe très sincèrement au texte de Yannick CHAUMETTE que vous trouverez en bas de page.
Avis de décès consultable sur :
<http://memoire.lavoixdunord.fr/espace/arthur-louart/333945>
Patrick Pognant (27/06/2016)
Préambule
En préambule à ce récit de vie de prisonnier de guerre au Stalag XI A, je tiens à remercier vivement M. Yannick Chaumette (voir la page consacrée à son père) qui, depuis plusieurs années, enrichit ce site en lui donnant des précisions historiques qui lui font parfois défaut. Grâce à ses recherches tenaces, il a pu entrer en contact avec M. Arthur Louart et lui a rendu visite sur son lieu de vie afin de recueillir son témoignage qu’il a retranscrit et que nous sommes honorés de mettre aujourd’hui en ligne. Nos remerciements vont aussi à M. Louart qui a compris l’intérêt de faire partager aux autres ses souvenirs de prisonnier et nous a confié des documents pleins d’intérêt.
Patrick
Pognant
Paris, le 17 octobre 2014
Transcription de l’enregistrement
de l’entretien
entre Arthur Louart et Yannick
Chaumette
Dieppe, le 22.08.2014
récit agrémenté de 26 photographies
© 2014 Arthur louart
Capture et
acheminement en Allemagne
Mais le désordre est
indescriptible, les hommes sont dispersés, séparés de leur unité et cherchent
désespérément à monter à bord des bateaux ; les Anglais qui donnent
priorité à leurs troupes, font quelquefois usage de violence à l’égard des soldats
français.
N’ayant pu embarquer, je suis capturé le 15 juin 1940
à Dunkerque. Commence alors pour moi le
périple vécu par tous les prisonniers. Dans mon cas, ce sera d’abord Béthune,
puis Verdun. Ces premières étapes sont toujours accompagnées des propos
rassurants des gardiens concernant notre future remise en liberté. Ces fausses
nouvelles sont destinées à endormir d’éventuelles tentatives d’évasion : « La grande idée des Allemands, c’était
de nous bourrer le crâne : on allait toujours être délivrés ». Chaque
étape était accompagnée d’un tri parmi les prisonniers suivant leurs
professions (cultivateurs, ajusteurs, mineurs etc.) afin de les diriger par la
suite au mieux des intérêts des vainqueurs.
À Verdun, je suis embarqué avec mes camarades dans des wagons à
bestiaux qui partent en direction de l’Allemagne. Notre voyage dure trois jours
et les quarante hommes qui sont enfermés avec moi dans le wagon ne bénéficient
d’une halte que pour la vidange des seaux d’aisance et le réapprovisionnement
en eau potable. L’entassement est tel qu’il faut établir un tour de rôle pour
permettre à chacun de s’asseoir un moment à même le sol.
Arrivés au Stalag XI-A d’Altengrabow,
nous
subissons les opérations de désinfection : douche, rasage, épouillage, et passage de nos vêtements à
l’étuve. Ces différents traitements permettent de nous débarrasser complètement
des poux et des puces. L’une des premières consignes que les autorités
du camp demandent aux prisonniers de respecter sous peine de sanctions très
lourdes (pouvant aller jusqu’à la peine de mort en cas d’infraction) est de ne
pas fréquenter de femmes allemandes.
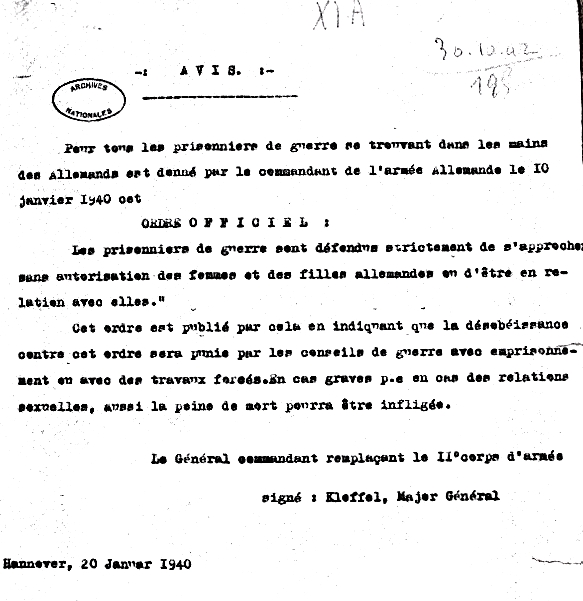
Avis interdisant les contacts entre les femmes allemandes et les prisonniers (1940)
© Archives Nationales.
Arthur Louart (à droite) avec un camarade de captivité.
Arthur Louart (au centre) avec deux camarades de captivité.
Le kommando 544.10
À l’occasion d’un dernier tri, je suis
affecté au kommando 544.10 dont le lieu de travail est l’usine Maschinenfabrik Wolf, dans le quartier
de Buckau à Magdeburg. J’y travaillerai jusqu’à ma tentative d’évasion, en
décembre 1944. Ce kommando compte parmi les plus importants de Magdeburg :
des Russes, 200 Français et 300 Belges Wallons. À mon arrivée à l’usine, ces
derniers sont dans une rage folle. J’en apprends vite la raison : leurs
compatriotes flamands viennent d’être renvoyés dans leurs foyers en vertu du
traitement de faveur que l’Allemagne nazie réserve aux peuples germaniques.
En dépit des tentatives allemandes de tirer le meilleur profit des
compétences professionnelles des prisonniers, je me vois affecté à un poste où je dois
travailler avec une perceuse, outil dont j’ignore le maniement. S’ensuivront de
très nombreux forets mal aiguisés et des mèches cassées en abondance ! Nos
horaires sont simples : deux rotations de 12 h par jour, cinq jours par
semaine, le samedi après-midi et le dimanche étant normalement réservés au
repos. Mais cette règle est ignorée chaque fois que de la main d’œuvre est
nécessaire pour des corvées supplémentaires comme par exemple le déchargement
des wagons de tourbe, combustible utilisé à l’usine pour faire fonctionner les
machines.
La vie du kommando s’organise peu à peu. À l’usine, j’ai pour voisin d’établi
un Allemand qui se révèle être un brave homme, ancien de 14-18. Les contacts que
nous avons sont corrects. Ceux avec les ouvriers de Magdeburg qui travaillent
dans l’usine sont souvent basés sur le troc. Les prisonniers proposent des
cigarettes ou du chocolat, produits très recherchés par les Allemands du fait
de la pénurie régnant dans le pays en
guerre.
D’autre part au fur et à mesure de
l’avancée de la guerre, Magdeburg, grand centre industriel, devient la cible de
plus en plus fréquente des bombardements alliés. Le dimanche les prisonniers
sont alors souvent réquisitionnés pour s’occuper des travaux de déblayage dans
les quartiers touchés. Notons au passage que Magdeburg, étant donné son
importance stratégique, a été très tôt la cible des avions alliés. La Maschinenfabrik Wolf a même été
endommagée lors d’un de ces raids. Ce n’est donc pas tous les dimanches que mes
camarades prisonniers et moi-même avons pu bénéficier de notre repos hebdomadaire !
Magdeburg subit dans les derniers temps de la guerre un véritable
déluge de bombes. Je suis témoin des dégâts énormes occasionnés dans le centre de
la ville. Dans ce cas, les Allemands se contentent alors de fermer par une
rangée de barbelés l’accès aux immeubles endommagés. Aucune recherche n’est
entreprise dans les amas de décombres…
Les bombardements sur Magdeburg font naître en moi des
sentiments mitigés : je balance entre la joie de voir l’Allemagne durement
frappée et la peur d’en être moi-même la victime innocente. Il m’est même arrivé
d’assister à une bataille aérienne au dessus de la ville.
Les liens avec la France, prennent la forme de colis envoyés par les
familles des prisonniers. Ils permettent d’adoucir un tant soit peu la dure vie
au kommando en procurant à leur destinataire quelques douceurs, du tabac, des
vêtements chauds, un complément de nourriture. Après un passage au contrôle,
les colis sont remis à leurs destinataires.
Au centre de Magdeburg, une
ancienne salle de bal et de concerts, le Kristall Palast, est transformée en
camp d’internement pour prisonniers de guerre. Des châlits sont installés dans
la salle de spectacle et certains occupent même la scène, un hôpital est aussi
abrité dans ses murs. Au Kristall Palast se trouve l’un des kommandos les plus
importants de la ville, le 544.10, dont les prisonniers travaillent chez les
artisans de la ville ou les entreprises environnantes (Rex Werke).
Le centre de tri des colis y est également installé et je m’y rends
quelquefois avec une charrette pour récupérer les paquets destinés aux
camarades de mon détachement. Dans l’ensemble il y a peu de vols et les colis
du kommando 544.10 sont convenablement remis à leurs destinataires.
Trois membres du Kommando 544.10 - Arthur Louart est au centre.
Le contact avec le pays est aussi maintenu grâce au courrier. Nous
recevons comme un rayon de soleil les lettres ou les cartes des parents, des
frères et sœurs, des amis, de l’épouse, qui y joint parfois la photo des
enfants. Ainsi gardons-nous, par l’esprit du moins, ce lien nécessaire à notre
équilibre psychologique.
Mais les nouvelles sont
parfois mauvaises : l’annonce
du décès d’un proche, une maladie grave pour laquelle on ne peut rien faire
depuis le camp, ou encore celle de l’infidélité d’une épouse, la séparation
d’avec celle-ci, plongent le prisonnier dans un désespoir sans fond. Je suis,
hélas, quelquefois témoin de ces chagrins inconsolables et j’essaye d’apporter
un peu de réconfort à mes malheureux camarades en les serrant dans mes bras, comme
on le ferait avec un enfant. Messagères de bonnes ou de mauvaises nouvelles,
les lettres passent toutes à la censure et sont distribuées aux prisonniers,
frappées du tampon geprüft (contrôlée).
Au kommando, nous parvenons à nous tenir informés de l’évolution de la
guerre. Moyennant un peu de tabac ou de chocolat, nous sommes parfois autorisés
par nos gardiens à nous approcher des postes de TSF. Quelquefois ce sont les Allemands eux-mêmes
qui nous apportent l’information, en particulier lorsqu’elle relate une
victoire de la Wehrmacht ! Ainsi l’échec de la tentative de débarquement à Dieppe
le 19 août 1942 (Opération Jubilee) qui se solde par un désastre
pour les Alliés, nous est-il joyeusement
annoncé à trois heures du matin !
Mais les nouvelles ne
sont pas toutes aussi catastrophiques pour les prisonniers français. Bien plus
tard, dans la journée du 6 juin 1944, celle
du débarquement allié en Normandie (réussi celui-ci !) m’est communiquée en
fin d’après midi grâce à l’indiscrétion d’une sentinelle. Voulant en informer
mes camarades sans trahir mon informateur, je patiente une heure, puis entre
dans mon atelier, bras levés en signe de victoire et je leur annonce sobrement
par deux fois, la voix tremblante d’émotion : « Ça y est ! » Et j’entends alors autour de moi les
commentaires navrés des Allemands : « Ah ! Il sait ! »
Le même jour, au moment
de la dislocation des prisonniers après l’appel du soir qui, pour une fois, est
rapidement mené, les hommes du 544.10 restent au garde à vous. Intrigués les
Allemands leur demandent une explication : « Nous rendons hommage à ceux (des nôtres) qui sont tombés aujourd’hui ! » Le kommando tenait sa
vengeance !
Vers la fin de la captivité une nouvelle vermine fait son apparition
dans le kommando : les punaises ! Elles nous sucent le sang la nuit
et le jour et se réfugient dans les fissures des charpentes de bois qui
constituent l’ossature des bâtiments où nous logeons. De ce fait, elles
échappent à l’étuve, comme les poux. Les gardiens, en étant eux-mêmes victimes,
sont incapables de nous débarrasser de ce nouveau fléau. Nous décidons donc de
faire partager notre infortune à la population : c’est ainsi qu’à l’usine,
nous déversons chaque jour des boîtes de punaises dans les vestiaires des
civils qui travaillent avec nous. Certains échos nous rapportent bientôt
l’arrivée des bestioles en ville, pour notre plus grande joie. D’autant plus
que, dans le même temps, le bruit se répand que ce sont les Américains qui les
déversent à l’occasion des bombardements…
La baignade sur les bords de l’Elbe
Parmi les rares moments de véritable
détente que les prisonniers peuvent goûter, il en est un auquel nous tenons
particulièrement : la baignade. C’est, à la bonne saison, le dimanche que
cette activité est possible, à condition toutefois qu’aucune corvée
supplémentaire ne vienne interférer.
L’hygiène – ou plutôt son absence – dans
les baraques du kommando étant une grande cause du malaise des prisonniers,
cette sortie régulière sur les bords de l’Elbe prend rapidement à nos yeux une importance
capitale : véritable bouffée d’air frais dans l’univers étouffant de la
captivité, elle permet de laver les corps, de les débarrasser de la vermine des
paillasses et de détendre des muscles endoloris par le travail de la semaine. Moment
inestimable que l’on tient à conserver par-dessus tout ; un accord est
rapidement conclu parmi les captifs du kommando : aucune évasion ne sera
tentée à cette occasion et ce, pour éviter que l’activité qui nous procure tant
de bien-être soit supprimée. À noter que ce pacte non-écrit ne vaut pas lors
des promenades et autres déplacements de groupes : dans ce cas toute
occasion de s’évader est bonne à saisir ! La baignade représente donc en
ce sens, une activité à part.
Globalement, les rapports avec les
gardiens sont corrects. Encadrés par une garde légère formée de soldats assez
âgés (souvent des anciens de la Grande guerre), nous sommes amenés dans des
lieux fréquentés également par les habitants de Magdeburg et, curieusement,
aucune interdiction ne nous est signifiée de nous baigner parmi eux ! Naturellement,
dans de telles conditions des contacts se nouent, et en particulier, avec des
femmes allemandes. Les bords de l’Elbe deviennent alors le lieu des rendez-vous
amoureux clandestins, malgré la stricte interdiction que les autorités
militaires ont fait connaître tant aux prisonniers qu’à la population civile.
Les peines encourues par les uns et les autres sont pourtant très sévères, mais
elles ne parviennent cependant pas à empêcher les rencontres.
Les sociétés théâtrales
L’un des dérivatifs les plus prisés des prisonniers sont les sociétés théâtrales. Le nom de la troupe cherche toujours à évoquer, avec un humour triste, la captivité : par exemple celle du Kommando 544.25, Les Captifs endiablés. Celle de mon kommando n’échappe pas à la règle du clin d’œil : Les Tréteaux en K.G.
J’ai tôt fait d’intégrer la troupe et je suis bientôt à l’affiche de nombreux spectacles :
– Le Mystère de Kéravel ;
– Argent de suite ;
– Le Club des gangsters ;
– Feue la mère de Madame ;
– 21 juin 1940 : Une Nuit au bouge ;
– Noël 1941 : participation au spectacle des Tréteaux en KG : Les Tréteaux en folies ;
– 20 avril 1942 : Lidoire ;
– 7 juin 1942 : Carmen ;
– 11 octobre 1942 : Une Déclaration de revenus, Fausse monnaie ;
– 1er novembre 1942 : Dans l’ombre ;
– Noël 1942 : Fric-frac ;
– Pâques 1943 :
Bichon.
Dans un premier temps les moyens manquent cruellement pour donner l’illusion de vraies représentations théâtrales. Mais peu à peu les gardiens allemands acceptent de nous fournir des vêtements civils que nous n’aurons la permission d’utiliser que sur scène, bien entendu ! Un strict contrôle est effectué sous forme de comptage des vêtements au moment du prêt et de leur restitution.
À nouveau,
au kommando 544 .10, un accord est passé entre les
« acteurs » : personne n’utilisera des vêtements civils pour une évasion. Là
encore, le risque pour ceux qui restent serait de se voir privés d’un dérivatif
fort apprécié. Cette ligne de conduite est pour nous « sacrée ».
Le
succès de ces représentations est très grand parmi les prisonniers et la troupe
des Tréteaux en KG va même se
produire dans d’autres kommandos. À cette occasion, je noue des liens étroits
avec quelques prisonniers. Après guerre, mes camarades de Tréteaux et moi-même
prendrons l’habitude de nous revoir de façon régulière lors de réunions
annuelles à Paris.
Quelques photos depuis les coulisses des Trétaux en KG
Répétition. Arthur Rouart est debout, sur la droite en bras de chemise.
Arthur Louart, à gauche, tient le micro...
Séance de maquillage.
Quelques membres de la troupe des Trétaux en KG.
La transformation
Mise en place au début de l’année 1943
cette mesure permet aux prisonniers de guerre d’être « transformés » en travailleurs dits « libres ».
Devant le refus massif des captifs d’abandonner leur statut de prisonniers de
guerre, et une fois les menaces de représailles épuisées, la transformation est
souvent appliquée par les Allemands de façon autoritaire et collective, par
kommandos entiers.
À cette
occasion je suis témoin du désespoir d’un de mes bons camarades,
Pierre Salmon, qui, croyant se retrouver avec moi, avait accepté la
transformation. Je n’avais rien dit de mon intention de refuser pour
laisser mon
camarade choisir en conscience. Mais qu’ils soient transformés ou non,
les
prisonniers conserveront entre eux de bons rapports par la suite.
L’évasion et la reprise
En 1944, le contexte tourne définitivement à l’avantage des forces alliées
et des Russes. Cette année-là voit, en conséquence, le nombre de tentatives
d’évasion augmenter de façon significative.
Profitant d’une occasion qui se présente, je franchis le pas et m’évade
en décembre 1944 en compagnie de trois camarades, mais de façon spontanée, sans
préparation, sans plan. Nous couchons dans des meules de paille, mais nous
avons rapidement des difficultés à trouver de la nourriture ; nous sommes quelquefois dépannés par
d’autres prisonniers rencontrés dans les champs au cours de notre périple. Mais
nous sommes bientôt accablés de fatigue et nous sommes repris lors d’un
contrôle de police. Je suis ramené au camp d’Altengrabow et enfermé quelque
temps dans une cellule à l’écart.
Je parviens néanmoins à communiquer avec des prisonniers arrivant de Prusse
qui me racontent leur kommando, leur lieu de travail, les conditions locales
etc. Je passe ensuite devant une commission disciplinaire et là, fort des
renseignements obtenus, j’invente une
histoire selon laquelle j’étais dans un kommando en Prusse et je n’avais fait
que suivre mes patrons qui fuyaient l’avancée des Russes. Donnant un faux nom
(celui de mon beau-frère !) je réussis ainsi à éviter le renvoi à
Magdeburg où je craignais de retourner à cause des bombardements. Je termine donc ma captivité à proximité
de Salzwedel, petite ville située au nord ouest de Magdeburg. En 1945, tous mes
dimanches se passent à déblayer les décombres de la gare, complètement détruite
par les bombardements alliés.
C’est à Salzwedel que je suis libéré par les Américains fin avril 1945.
Peu à peu, au fur et à mesure de l’avancée des troupes alliées et russes, tous
les prisonniers sont libérés partout en Allemagne. À cette occasion, je suis
témoin de scènes de vengeance sur la population civile qui m’ont traumatisé, particulièrement
de la part des prisonnières russes qui avaient eu à endurer d’abominables
souffrances causées par les Allemands. Les prisonniers français ne font rien
pour les arrêter, ce que je regrette peut-être aujourd’hui, mais
le contexte de l’époque ne plaidait pas pour la mansuétude à l’égard des
Allemands.
De même, j’apprends que le responsable
de l’usine Maschinenfabrik Wolf, un
certain Peters, a été pendu par les prisonniers russes du kommando 544.10 sur lesquels
il s’était acharné avec sauvagerie pendant leur captivité.
Tout va très vite à partir de ce moment-là
pour mes camarades et moi. Nous sommes chargés par des soldats noirs américains
dans des camions pour être transportés à Hanovre, ce qui me vaut une des plus
grandes frayeurs de ma vie car « si
les camions n’étaient pas blindés, les chauffeurs noirs l’étaient, eux ! ».
Après une séance de
désinfection et d’épouillage, trois jours après être arrivé à Hanovre, j’embarque
à bord d’un avion qui atterrit au Bourget d’où je rejoins le centre de
rapatriement du Vel’ d’Hiv’ pour y accomplir les formalités de retour.
Observations sur le livre de fabienne montant:
altengrabow stalag XI-A
LA PROMISCUITé : c’est une chose qui m’a
énormément pesé pendant toute ma captivité : aucun moment où les
prisonniers sont seuls, mêmes pour satisfaire aux besoins les plus intimes. De
plus, les hommes de toutes conditions se trouvent mêlés ; certains, issus
de régions de France reculées, peu accessibles, n’ont aucune habitude de la vie
en société et se comportent comme s’ils étaient seuls, inconscients de la gêne
qu’ils provoquent autour d’eux.
LES DéCèS :
j’ai toujours vu les soldats allemands rendre les honneurs militaires aux
prisonniers décédés en captivité. J’ajoute que, pour ce qui est de mon
kommando, ceux-ci sont généralement enterrés dans le cimetière communal du lieu
de travail.
LES RUSSES : j’ai
été témoin des exactions répétées des Allemands sur la population des
prisonniers de guerre russes ce qui, à mes yeux, explique que ces derniers se
sont déchaînés sur leur geôliers à la libération des camps.
LES
HOMMES DE CONFIANCE DES KOMMANDOS : dans le 544.10, ils ont toujours été
choisis par les prisonniers, jamais désignés par les Allemands.
MISSION DE L’AMBASSADEUR
SCAPINI : je n’ai jamais vu personne venir visiter mon kommando !
« Scapini était considéré comme un
collabo ! ».
C’est avec une grande
tristesse que nos avons appris, de façon fortuite et bien tardivement, le décès
d’Arthur Louart le 1er août 2015 à l’âge de 96 ans. Arthur Louart
était certainement l’un des derniers survivants parmi les prisonniers de guerre
du Stalag XI-A d’Altengrabow.
Après son retour de captivité, il
avait tenu à perpétuer la mémoire de cette sombre période de notre
histoire en exerçant de multiples responsabilités militantes au sein de
nombreuses associations. Que ce soit auprès de l’Office National des
Anciens Combattants (ONAC), de l’Union Française des Anciens
Combattants (UNAC), de la Mutuelle Santé des Combattants Déportés
(MCD), du Souvenir Français, pour ne citer que les principales, Arthur
Louart s’est donné sans compter, tant au niveau national que régional,
à la cause des anciens captifs. Il apportait aussi, périodiquement, le
témoignage de son expérience de prisonnier de guerre, travailleur forcé
pendant cinq longues années au cœur de l’Allemagne nazie.
C’est d’ailleurs grâce à sa
participation au documentaire J’attendrai (de Jérôme Lambert et
Philippe Picard, Kuiv productions, www.kuiv.com), que j’ai eu l’honneur
de faire la connaissance d’Arthur Louart. Malgré un état de santé
fragile, il a accepté sans hésiter de me recevoir dans sa maison de
retraite de Dieppe pour me parler de ses années de captivité.
Surmontant sa fatigue, il m’a entretenu, pendant une journée et demie,
de la captivité telle qu’il l’avait vécue au camp d’Altengrabow. Arthur
Louart m’a ouvert avec une grande confiance ses très nombreuses
archives personnelles et a accepté de les voir mises en ligne sur le
site du Stalag XI-A.
J’avais, à cette occasion,
recueilli son témoignage dont la synthèse se trouve dans les pages qui
lui sont consacrées sur le site. Son esprit, toujours vif, m’a permis
de trouver de nombreuses réponses au sujet de la captivité de mon
propre père qui, hasard de l’histoire, avait été versé dans un
Arbeitskommando de Magdeburg, voisin de celui où travaillait Arthur
Louart.
Ce décès nous prive, nous les
enfants des captifs attachés à la mémoire de nos pères, d’une personne
de grande qualité qui est restée, jusqu’à la fin de sa vie, un témoin
militant de cette sombre période. Cependant, sa disparition ne saurait
effacer l’engagement de sa vie qu’il a généreusement mise au service de
la connaissance et de l’édification des jeunes générations.
Soyons en conscients et reconnaissants.
< Retour rubrique Les Deux dernières Guerres mondiales
< Retour à la page-écran d'accueil du STALAG XI A