< Retour rubrique Les Deux dernières Guerres mondiales
< Retour à la page-écran d'accueil du STALAG XI A

Louis KLINKENBERG Né le 1er février 1908
à Mont-Dison (près de Verviers),
sous le nom de Klenkenberg
(à la suite d’une
erreur administrative qui sortait ses effets depuis trois générations),
et décédé
à Verviers (Belgique) le 15 novembre 1981.
Je
suis honoré d'accueillir dans ces pages consacrées au Stalag XI A les
documents de la famille Klinkenberg consacrés à M. Louis Klinkenberg et
à ses compagnons wallons du Stalag XI A. Comme vous pourrez le
constater, ils enrichissent la banque de documents proposés sur ce
site, d'une part avec des œuvres graphiques (des dessins et une
aquarelle), et, d'autre part, avec des documents rares et signifiants
pour tous ceux qui s'intéressent à cet aspect de la Seconde Guerre
mondiale, soit un total de 31 documents*. Ils ont été ordonnés en trois
groupes :
1) les œuvres graphiques ;
2) les photographies de prisonniers ;
3) les documents divers (dont un article de presse).
Je remercie sincèrement le Royal syndicat d'initiative de Theux-Franchimont pour son autorisation de reproduction d'un extrait de son Bulletin mensuel : Le pays de Franchimont, 64e année, n° 770, novembre 2011, pp. 12-13.
Les textes, légendes et documents sont la
propriété des Klinkenberg et sont donc protégés par le copyright.
Pour
toute information complémentaire et demande d'autorisation, merci de
vous adresser à M. Jean-Marie Klinkenberg : jmklinkenberg@ulg.ac.be

Quelques esquisses de
scènes du travail en kommando.

Le Lazaret (hôpital
du camp) 22.09.1941.






Au camp, Louis Klinkenberg
portraiturait aussi ses camarades de captivité.
Pour réaliser ce travail, il
avait un crayon gras, que lui avait donné un religieux lazariste
(à son retour,
il ramena comme un trophée ce minuscule crayon, qui n’avait plus qu’un
centimètre et demi de long).
Il vendait ses portraits pour un demi-paquet de
tabac ou pour une somme variant de 1 à 1,5 marks
(1 mark pour un portrait
de profil, plus facile et rapide à exécuter qu’un portrait de face…).
Dans
l’interview reproduite ci-dessous (article de presse), son camarade Albert Kaivers parle d’un de ces
portraits (en lui donnant la valeur de 1 pfennig !).
Cette activité lui a
littéralement permis de survivre :
avec ses Lagermarks (voir photo ci-dessous),
il achetait des cigarettes, qu’il échangeait
ensuite contre un supplément de pommes de terre.
Le portrait de gauche (ou le premier en fonction de votre navigateur) est une
esquisse,
portant au dos la mention « un mineur de Charleroi, ami de Henri
Petit ».
Au dos du second, il a indiqué :
« Ce dessin est le dernier
avant mon retour au pays. C’est celui d’un violoniste qui, dans la fièvre du
départ, a oublié de le reprendre et de le payer. »

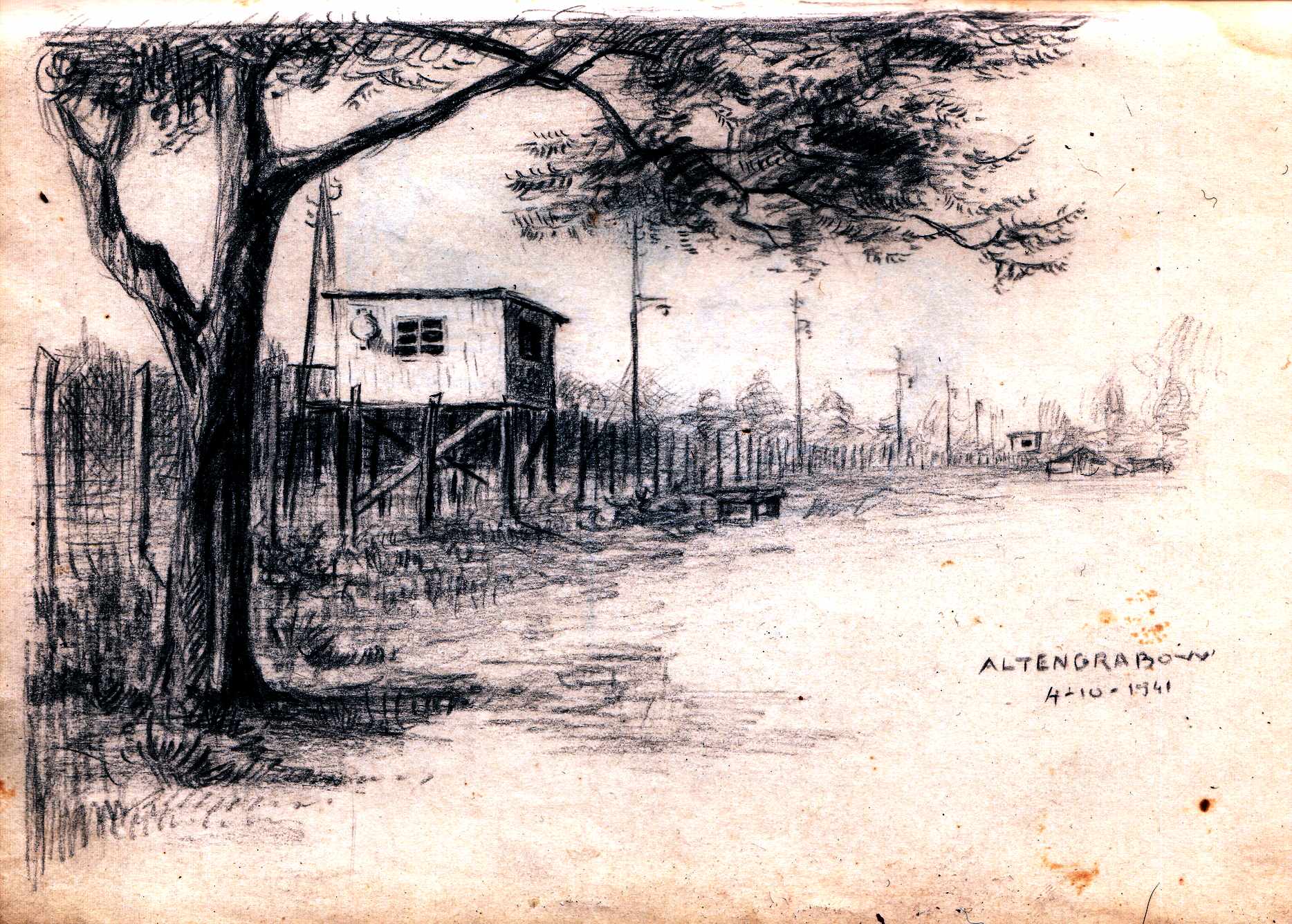




Henri Habsch. Encre de chine et crayon s.
papier, rehaussé à la gouache,
25 x 18, 1940, coll. Lucien Klinkenberg.
Louis Klinkenberg n’était pas le
seul artiste à peindre la vie au camp.
Ainsi, on peut contempler cette "œuvrette" de Habsch, qui
travaillait au service « Éducation » (on dirait aujourd’hui
« Animation »).
On remarquera le fait que les croisillons des fenêtres de cette chambre apparemment
confortable sont faits de fils barbelés.


Louis Klinkenberg, aquarelle s. papier, 26 x 32, coll. Annette Klinkenberg, 1942.
Ce troisième tableau de Henri Habsch présenté sur cette page,
est donc le portrait du KG Louis Klinkenberg, réalisé au Stalag la même année que le précédent.
L'internaute intéressé par les oeuvres de Henri HABSCH
peut voir deux autres aquarelles de cet artiste réalisée au Stalag XI A, Sombre dimanche

Quelques prisonniers belges à Altengrabow. Louis Klinkenberg est à l’extrême gauche (entre 1940 et 1942).

Autre groupe de prisonniers
belges, datée du 4 mars 1942.
Louis Klinkenberg est le quatrième à partir de la
gauche. Les autres n’ont pu être identifiés.
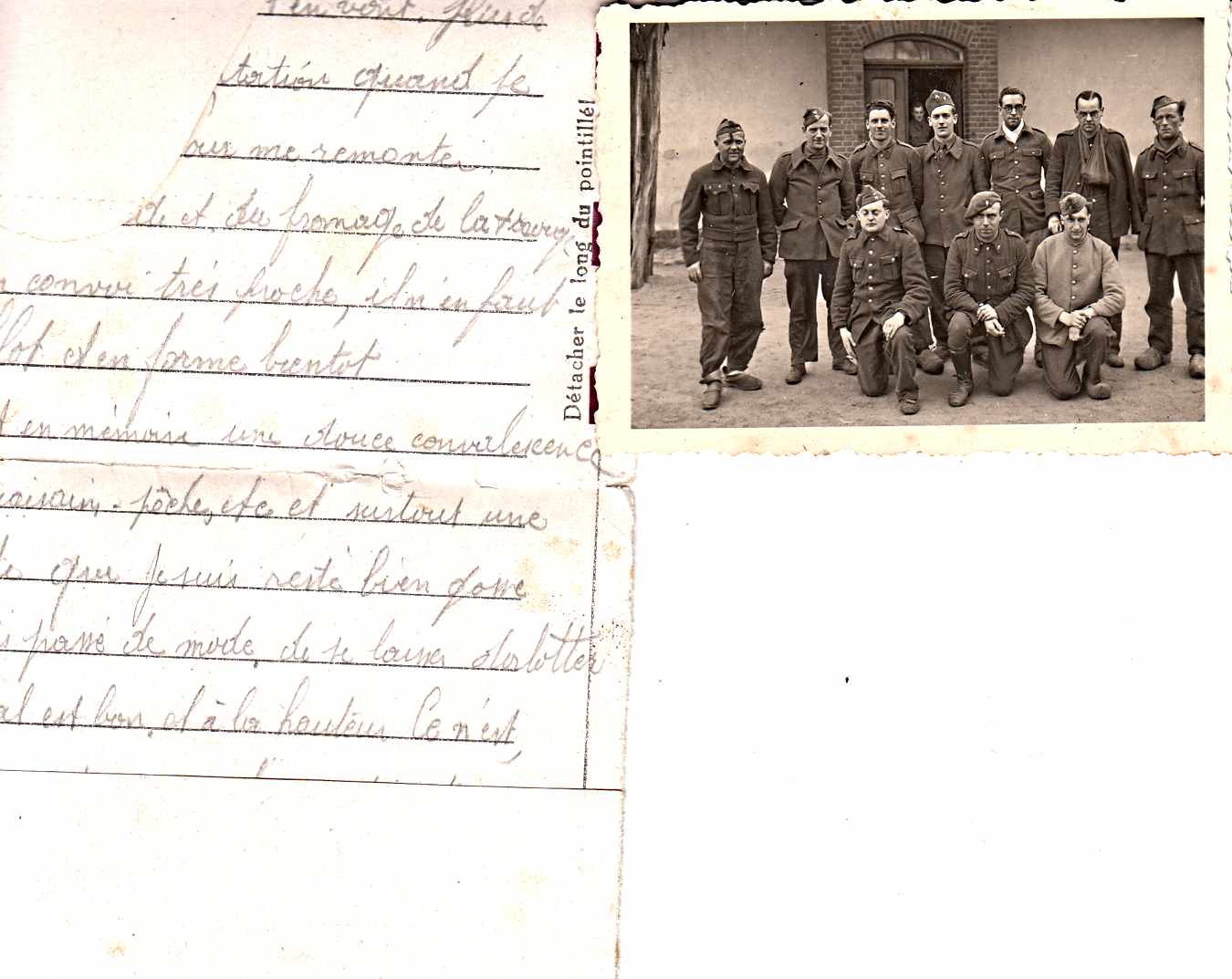
Dernière photo, datée du 6 mai
1942, et collée sur une lettre standardisée de la poste spéciale des
prisonniers de guerre.
Voir agrandissement ci-dessous :

De gauche à droite :
Grégoire, Gilsoul, Albert
Kaivers, Louis Klinkenberg, Dartois, Grignac et Arsène Finck.
Au premier
rang : Delville, Lenoble et Landresse (dont les prénoms ne sont donc pas
connus).

Sur le quai de la gare centrale de
Verviers.
Le retour du prisonnier, le 24
mai 1942. Nombreux sont ceux qui n’ont pas eu ce bonheur.


Après la tourmente, en 1945 ou 1946,
Louis Klinkenberg, à gauche, avec deux camarades
de captivité, dont Albert Kaivers, à droite.

Plaque-matricule de Louis
Klinkenberg.
Dans les statistiques, les prisonniers de guerre étaient autant de
« Stücke » (littéralement : pièces).
Le Stück Klinkenberg
portait le matricule 71347.

Lagergeld, ou « monnaie des
camps de prisonniers de guerre » : ticket d’une valeur de 1 mark
ayant appartenu à Louis Klinkenberg.
Les prisonniers ne pouvaient détenir de
l’argent allemand, mais uniquement cette monnaie,
qui avait cours à la cantine du camp mais était inutilisable en dehors (sauf
pour les prisonniers détachés en Kommando).
Bien sûr, cela n’empêchait pas les
trafics ; et, de toute manière, l’unité de compte la plus régulièrement
utilisée était la cigarette.

Lettre à la Croix rouge.
Une des lettres de la poste
spéciale des prisonniers de guerre.
On ne pouvait écrire qu’au crayon à
l’aniline, et en principe seulement sur les lignes.
Et, bien sûr, le courrier
était censuré (on voit nettement le cachet « approuvé » — geprüft — de la censure du Stalag).


Quoique sèche comme un
formulaire, ce qu’elle est, la première carte dut être bouleversante pour
toutes les familles de prisonniers.
Jusqu’à son arrivée, elles vivaient dans
l’ignorance du sort réservé au leur : tué ? blessé ?
disparu ?
Celle que put envoyer le Kriegsgefangene Klinkenberg est datée
du 28 juin 1940.
Envoyée à l’adresse de ses parents, elle y arriva courant
juillet, bien avant que son épouse ne rentre de son exode français, le 21 août.

Page arrachée du carnet (recto).

Avant l'envoi de la Poskarte présentée ci-dessus, au moment de s’embarquer
pour le trajet qui allait le mener au Stalag,
Louis Klinkenberg avait pu remettre à une
hollandaise une page arrachée à son carnet et adressée à M. Donnay, son beau-frère.
Il y
avait griffonné en hâte : « Passé comme prisonnier de guerre à Hulst
(Zélande) Hollande. Louis Klinkenberg, en bonne santé ».
Au dos, un cachet
disant sobrement « en vie » et, d’une main officielle, ce qui allait désormais
être son adresse : « Stalag XI a » et son numéro matricule.
Ce
bout de papier parvint miraculeusement à son destinataire.

Les colis — envoyés grâce à la Croix rouge — mirent, eux, un certain temps à arriver…

Les règles qui présidaient à la confection du contenu de ces colis étaient féroces…

Région d’Altengrabow, carte réalisée par
Louis Klinkenberg.
Localités sur l’axe
N-S : Ziesar, Magdeburger forth, Drewist, Altengrabow, Gr. Lübars, Loburg, Leitzkau.
Localités sur l’axe
W-E : Küsel, Theessen, Grabow, Burg.
Dans la zone gauche de la carte : Magdeburg, Biederitz, Heyrotsberge.


Le chemin
pour arriver à Altengrabow avait été long. Louis Klinkenberg avait un petit agenda
où il notait sobrement les étapes de son exil.
Capturés dans la province de
Flandre occidentale, lui et ses compagnons sont déplacés par petites étapes vers
l’Est puis dirigés vers la Hollande.
Au bord de l’Escaut, ils sont
encaqués sur un chaland.
Une navigation de cinq jours — où ils n’ont reçu qu’un
seul pain pour toute nourriture — les fait traverser une île zélandaise, puis remonter le Waal (un des bras du Rhin).
Une
journée entière de train les amène au stalag IX-A Ziegenhain, près de
Schwalmstadt.
Puis c’est la dernière étape : une journée et demie de wagon
plombé pour couvrir les quelques 300 km qui restent.
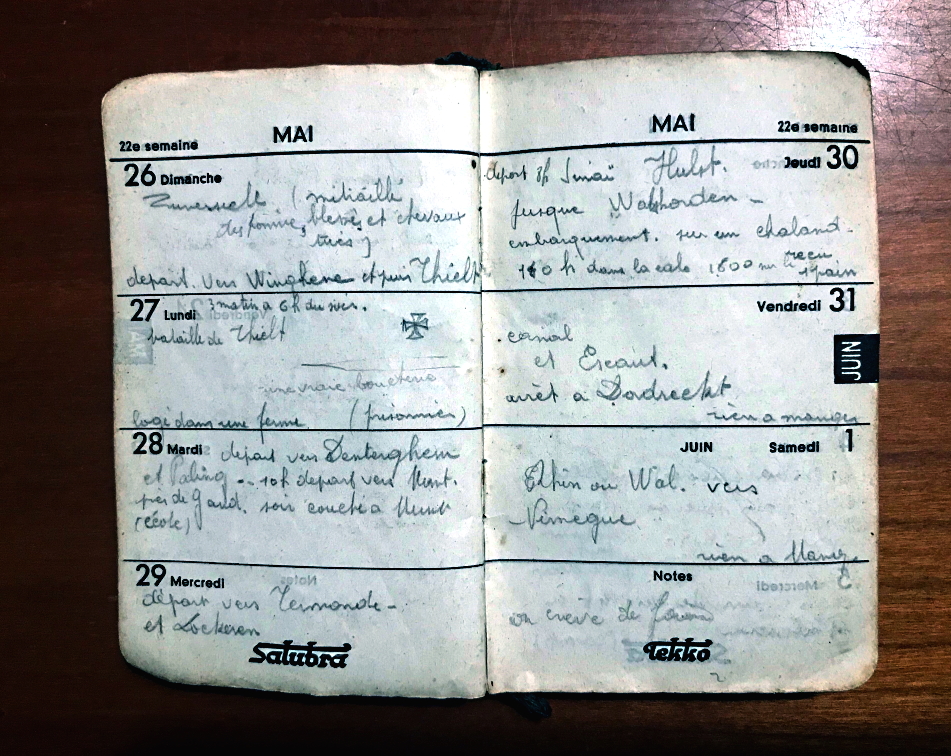
Transcription
Dimanche
26 mai 1940
Zwevezele
(mitraillé, des hommes blessés et chevaux tués).
Départ
vers Winghene [Wingene] et puis Thielt.
Lundi
27 mai
3
h. du matin à 6 h. du soir. Bataille de Thielt. Une vraie boucherie.
(Prisonnier). Logé dans une ferme.
Mardi
28 mai
Départ
vers Denterghem et Paling [?]. 10 h. départ vers Munt près de Gand. Soir couché
à Munt (école)
Mercredi
29 mai
Départ
vers Termonde et Lockeren [Lokeren]
Jeudi
30 mai.
Départ
8 h. Sinaï [Sinaai, en français Sinay], Hulst jusque Walshorden [Walsoorden].
Embarquement sur un chaland. 160
h. [hommes] dans la cale 1 600 sur le [pont ?]. Reçu un pain.
Samedi
1 juin
Rhin
ou Wal [Waal] vers Nimègue.
Rien
à manger.
On crève de faim.

Transcription
Dimanche 2 juin
Rien à manger.
Rhin vers Nimègue à 13 h.
Lundi 3 juin
Rien à manger.
Nimègue vers Rees
Mardi 4 juin
Débarquement à Rees. Café pain
saucisse. Départ à 13 h. 15.
Wesel, Bochum, Dortmund, Soest, Paderborn.
Mercredi 5 juin
Arrivée vers 4 h. à Ziguenheim
[Ziegenhain] (camp)
Jeudi 6 juin
Camp de Ziguenheim.
Vu Léon Schoonbrodt.
Vendredi 7 juin
Départ à 5 h. ½ en chemin de fer
Samedi 8 juin

< Retour rubrique Les Deux dernières Guerres mondiales
< Retour à la page-écran d'accueil du STALAG XI A